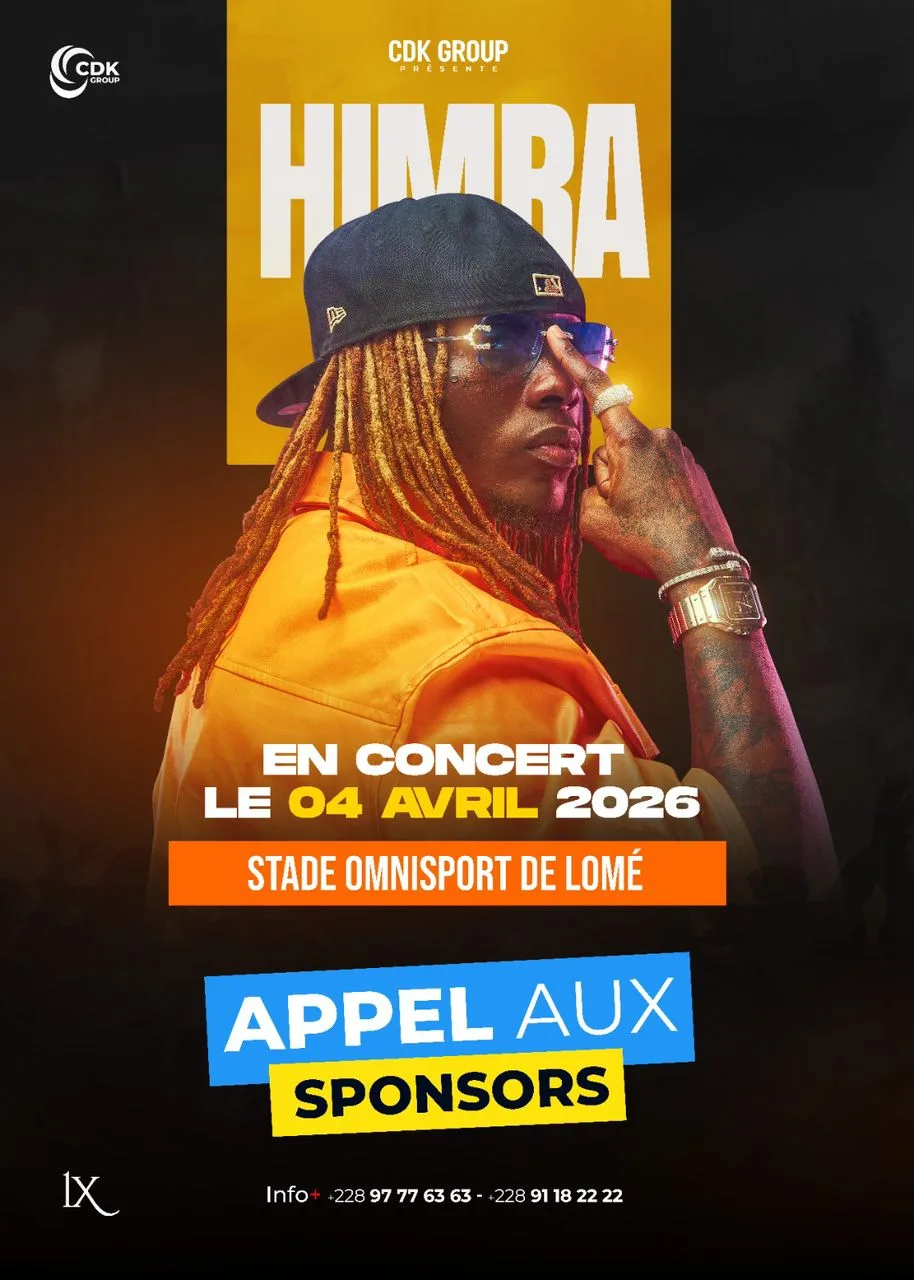Le pangolin, ce mammifère discret d’Afrique et d’Asie, est aujourd’hui l’une des espèces les plus menacées au monde. Chassé pour sa viande prisée et ses écailles très convoitées dans la médecine traditionnelle, il subit une pression sans précédent, tant en Afrique qu’en Asie.
En dépit des interdictions internationales, le commerce illégal du pangolin ne cesse de s’intensifier.
En Afrique, les populations de pangolins sont en chute libre. Le Nigeria est devenu un point névralgique pour l’exportation d’écailles vers l’Asie, tandis que l’Afrique du Sud se spécialise dans l’expédition d’animaux vivants. D’après l’ONG TRAFFIC, environ 2,7 millions de pangolins sont tués chaque année en Afrique centrale. En Afrique de l’Ouest, les estimations varient entre 650 000 et 8,5 millions de spécimens abattus entre 2009 et 2020.
Cette exploitation massive a conduit à leur classement en danger critique d’extinction sur la liste rouge de l’UICN. Pourtant, les saisies augmentent : près de 900 000 pangolins ont été illégalement commercialisés ces vingt dernières années.
Les écailles du pangolin, réduites en poudre, sont vendues dans les officines de médecine traditionnelle en Asie. Elles sont censées traiter divers maux : infertilité, malnutrition infantile, asthme, rhumatismes, et bien plus encore. Leur valeur symbolique et médicinale les rend extrêmement recherchées. En Chine, pourtant régulièrement dénoncée pour sa consommation de pangolins, une saisie record de 12 tonnes d’écailles a été opérée, équivalant à la mort de 20 000 à 30 000 individus.
Le Nigeria, en 2021, a intercepté 160 sacs d’écailles et plus de 60 sacs contenant d’autres restes d’animaux protégés, dissimulés dans des containers de meubles à destination du Vietnam. Ces chiffres témoignent de l’ampleur du fléau.
Le trafic de pangolins attire désormais les réseaux criminels internationaux qui, autrefois impliqués dans le commerce de l’ivoire, se sont réorientés vers cet animal. Les produits sont dissimulés dans des cargaisons de bois ou de nourriture, traversant plusieurs pays d’Afrique avant d’être expédiés depuis le port de Lagos. La corruption, la faiblesse des contrôles douaniers et la porosité des frontières alimentent ce commerce illicite.
Le braconnage compromet non seulement la survie de l’espèce, mais perturbe aussi leur reproduction. Faiblement armés pour échapper à l’homme, les pangolins s’enroulent instinctivement lorsqu’ils se sentent menacés, ce qui facilite leur capture. En RDC, au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique ou encore au Liberia, les écailles sont collectées dans les zones rurales, puis acheminées vers les grands centres logistiques.

Historiquement, l’Asie était le principal consommateur de pangolins asiatiques. Mais face à la raréfaction de ces derniers, le marché s’est délocalisé vers l’Afrique. À partir de 2008, les saisies d’écailles africaines se sont multipliées. Des pays comme l’Angola, le Kenya, la Zambie, la Guinée ou encore la Côte d’Ivoire sont désormais impliqués dans ce trafic mondialisé.
Même les pays occidentaux sont touchés, souvent en tant que points de transit ou de réception, à l’image de l’Allemagne ou des États-Unis. Cette mondialisation du commerce du pangolin illustre les limites actuelles des politiques de conservation.
Au Togo, la situation n’est guère différente. Bien qu’il n’existe pas de données chiffrées précises, les autorités ont saisi 37 kg d’écailles en 2018. Le code pénal togolais prévoit des peines allant jusqu’à cinq ans de prison pour les trafiquants. Malgré cela, le port autonome de Lomé reste un point de passage stratégique pour ces produits illégaux.
L’impact écologique est majeur. Sans les pangolins, certains insectes proliféreraient dangereusement, mettant en péril les écosystèmes forestiers. Ces animaux contribuent aussi à l’aération du sol et à l’équilibre de la biodiversité.

Ce commerce illégal s’inscrit dans une dynamique plus vaste de surexploitation des ressources naturelles, alimentée par la mondialisation et un rapport dégradé à la nature. Le pangolin, devenu symbole de cette crise, risque de disparaître si aucune action ferme n’est prise. Il est urgent de réconcilier protection de la faune et exigences humaines pour éviter que d’autres espèces ne subissent le même sort.