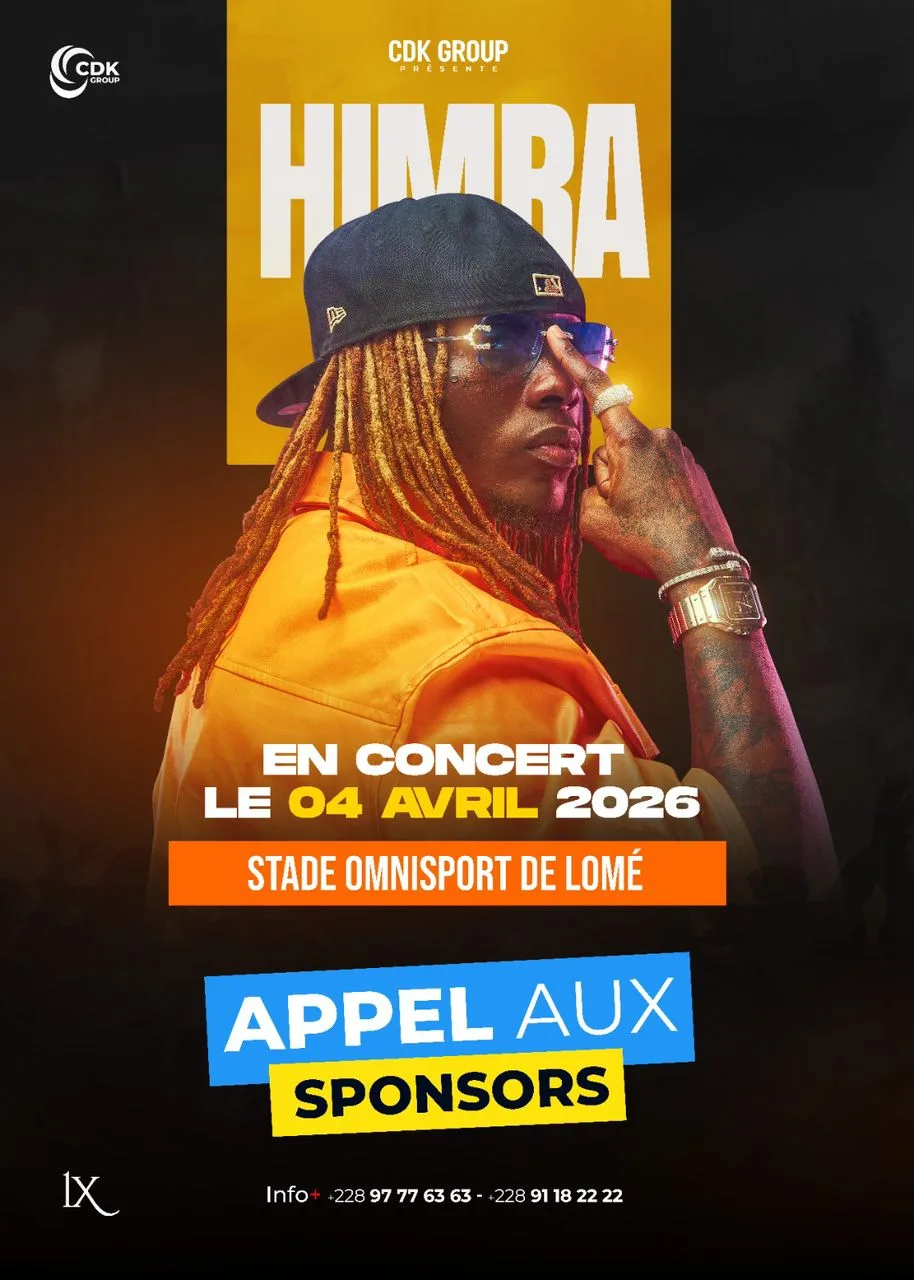Les Violences Basées sur le Genre (VBG) continuent d’augmenter dans le monde, en dépit de l’existence de nombreux instruments juridiques internationaux et nationaux destinés à protéger les droits humains, et plus particulièrement ceux des femmes.
Une étude publiée en 2019 par ONU Femmes révèle que « l’Afrique est la région du monde où les femmes courent le plus grand risque d’être tuées par un partenaire intime ou un membre de leur famille ». De son côté, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rapporte qu’une femme sur trois dans le monde a été victime de viol, de violence physique ou sexuelle, ou d’abus au moins une fois dans sa vie.

Au Togo, les résultats d’une enquête menée par Afrobaromètre et rendus publics en mars 2022, sous la direction du Center for Research and Opinion Polls (CROP), indiquent que près de la moitié des Togolais estiment qu’il est justifiable qu’un homme frappe sa femme si elle adopte un comportement qu’il n’apprécie pas.
Ce type de violence n’est que l’une des nombreuses formes de VBG présentes dans les communautés. S’ajoutent à cela des pratiques telles que les mutilations génitales féminines, les féminicides, le viol, le harcèlement sous diverses formes (physique, verbal, sexuel, ou encore cyberharcèlement), les mariages précoces et forcés, ainsi que l’exclusion sociale ou la précarité menstruelle.
Plusieurs facteurs contribuent à perpétuer ces violations des droits des femmes, parmi lesquels les normes socioculturelles, l’insuffisance des ressources allouées à la lutte contre ces violences, ainsi que la méconnaissance et la faible application des mécanismes juridiques existants.
Dans ce contexte, les médias, qui jouent un rôle crucial dans les représentations sociales, peuvent devenir des leviers puissants pour lutter contre les VBG. En abordant ces sujets de manière rigoureuse et en adoptant des chartes éthiques ou des codes de bonnes pratiques, les journalistes peuvent contribuer à exposer l’ampleur du problème et à modifier l’opinion publique. Un traitement juste et précis des informations relatives aux VBG est essentiel pour éviter la banalisation de ces violences et assurer que les auteurs ne restent pas impunis.
C’est dans cette optique que l’association féministe Ekina, qui milite pour une représentation équitable des femmes dans les médias et pour l’égalité des genres, a organisé le lundi 30 septembre 2024 un atelier de renforcement des capacités. Cet atelier, qui a réuni une cinquantaine de journalistes, portait sur « l’implication des médias dans la lutte contre les VBG et les stéréotypes au Togo ».
Ce projet vise à encourager les médias à s’intéresser davantage aux problématiques liées aux violences basées sur le genre, tout en les abordant de manière appropriée. Il a également pour objectif de sensibiliser le public aux VBG par le biais des médias.
En outre, il s’agit de former les jeunes femmes journalistes à l’utilisation de termes adéquats lorsqu’elles couvrent ces sujets, et de les sensibiliser à la question des stéréotypes de genre. Le projet prévoit également la production et la publication de six grands reportages et enquêtes journalistiques sur les VBG, ainsi qu’une campagne digitale comprenant la diffusion de 12 contenus (4 courtes vidéos, 4 podcasts, 4 dessins de presse) sur les plateformes du magazine de l’association.
Selon Hélène Doubidji, coordonnatrice du projet, il est impératif d’agir pour impliquer les médias dans la lutte contre les VBG et les stéréotypes au Togo : « Cet atelier rassemble aujourd’hui une cinquantaine de journalistes autour de la question des VBG et des stéréotypes au Togo. Il s’agissait de les former sur ces violences pour qu’ils puissent, à leur tour, sensibiliser le public par le biais de leurs médias. »
Diverses communications ont été présentées lors de cette rencontre, notamment sur le rôle des médias dans la lutte contre les VBG, l’impact de ces violences, et les chiffres clés associés. Une intervention portait également sur le traitement journalistique des questions de genre. Ces présentations, données par des experts de longue date, ont été jugées pertinentes par la coordonnatrice, qui a souligné l’importance de fournir aux journalistes les outils nécessaires pour traiter ces sujets et relayer l’information de manière appropriée.

Le projet est soutenu par le FONDS PANANETUGRI, premier fonds féministe d’Afrique de l’Ouest, dirigé par de jeunes filles et femmes (JFF). Ce fonds vise à soutenir les organisations de JFF en faveur de projets innovants promouvant un changement social en faveur de leurs droits.